Je viens de finir Eva dort, offert à l'impromptu par Carole, rencontrée aux premiers jours de janvier à la librairie. Moi, je lui ai offert Gioconda. Je ne sais pas si je trouverai l'énergie ou le désir de chroniquer mes lectures en cette année qui s'ouvre – la liste des romans, des essais lus, et des films regardés, s'allonge, délaissée, effilochée... Mais je suis heureuse de l'ouvrir par ce billet. Quel beau roman ! De ceux qui attestent, s'il en est besoin, de la vitalité du genre, de sa capacité à créer des personnages qui accompagnent encore nos vies et nos pensées – comment a-t-on pu si doctoralement mettre en cause sa légitimité, en ces temps de spéculation débridée du Nouveau Roman, et croire que l'on pouvait cesser de « raconter des histoires » ! Un de ces romans où l'on respire à l'aise, dont la langue paraît familière – et pourtant combien hérissée ici d'interminables vocables tyroliens truffés de consonnes ! - dont les images, les associations d'idées, les personnages semblent nécessaires et justes. Un roman plein de l'histoire de l'Italie, avec une belle traversée en train, depuis le Haut Adige – car c'est cette greffe autrichienne laissée par la guerre de 14-18, et sa douloureuse et violente histoire, qui est le socle du roman – jusqu'à l'extrême sud de la botte, à portée de main de la Sicile. - Il y a bien longtemps que je n'ai pas traversé l'Italie en train, dans un des ces compartiments à trois sièges face à face - on peut les étendre en position de lit. Bonheur des voyages dans les années 70 – 80, rideau tirés, yeux fermés pour éloigner le plus longtemps possible d'éventuels voyageurs intrus, beauté-malgré-tout des paysages dévastés par des constructions anarchiques, étrangeté des perspectives contradictoires entre la mer et les montagnes... Je m'y suis retrouvée.
Si Eva traverse l'Italie en train en ce dimanche de Pâques, c'est pour aller, in extremis, à la rencontre de l'homme qui avait donné à son enfance, brièvement, fermement, honorablement, la couleur du bonheur. Son presque père, Vito Anania, un jour perdu, et dont la perte a restauré dans sa vie l'omniprésence absolue, hautaine, tendre pourtant, de sa mère Gerda Huber, ex Matratze devenue cuisinière émérite au Grand Hôtel de Frau Mayer à Merano. Eva a donc grandi à l'ombre de Gerda, et le voyage en train retisse au fil de ses pensées, dans l'alternance un peu systématique des kilomètres franchis et des dates - ce procédé qui, dans nombre de romans ces temps derniers, devient une ponctuation bien trop facile, systématique et somme toute assez peu suggestive de l'intrigue. (C'est le seul reproche que j'adresse à l'autrice, Francesca Melandri, que je n'avais pas encore nommée). Le voyage en train retisse donc au fil de ses pensées l'histoire familiale de ces montagnards humiliés dans leur langue et le tissu le plus intime et social à la fois de leurs vies par le rattachement du Tyrol du sud devenu Haut Adige à l'Italie, avec l'histoire de Gerda, puis d'Eva.
J'ai découvert dans Eva Dort un pan de l'histoire italienne dont j'ignorais tout. Au fil de mes lectures nocturnes, la pluie martelant le vélux, j'en ai aimé les personnages, tous, même les plus modestes apparitions, comme celle du sacristain Lukas – ou détesté, mais compris, certains, comme Hermann et Peter, frustes, brutaux, tranchants, le père et le frère d'Eva.
Il est temps à présent que je laisse, pour vaquer, pour courir, cette chronique dont j'espère, au seuil de l'année, qu'elle vous donnera le désir de lire Eva Dort, fluidement traduit par Danièle Valin.
 Rembrandt - Les Pèlerins d'Emmaüs, détail. Paris, Musée du Louvre.
Rembrandt - Les Pèlerins d'Emmaüs, détail. Paris, Musée du Louvre.

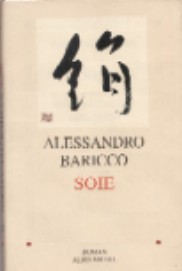


 Mal de pierres, Mal di pietre, Mali de is perdas en dialecte sarde. La voix de la narratrice, jeune femme éperdue d'amour pour sa grand-mère, retrace, recompose, retisse la vie de celle-ci : dans les années 40, grâce et gaucherie infinies mêlées, elle est au village celle que l'on courtise puis que l'on fuit étrangement, celle qui n'arrive pas à se faire épouser, aimée avec perplexité de son père et de ses sœurs, haïe de sa mère. Scandale : elle écrit des poèmes et des déclarations enflammées à ses soupirants. Folle, et atteinte du mal des pierres, coliques néphrétiques qui la terrassent régulièrement. Jusqu'à cette année 43 où, fuyant Cagliari détruite par un bombardement qui a anéanti sa famille et sa maison, arrive avec sa valise celui qui trouve refuge au village chez les arrière-grands-parents, et un mois plus tard épouse la grand-mère, malgré elle, qui ne l'aime pas.
Mal de pierres, Mal di pietre, Mali de is perdas en dialecte sarde. La voix de la narratrice, jeune femme éperdue d'amour pour sa grand-mère, retrace, recompose, retisse la vie de celle-ci : dans les années 40, grâce et gaucherie infinies mêlées, elle est au village celle que l'on courtise puis que l'on fuit étrangement, celle qui n'arrive pas à se faire épouser, aimée avec perplexité de son père et de ses sœurs, haïe de sa mère. Scandale : elle écrit des poèmes et des déclarations enflammées à ses soupirants. Folle, et atteinte du mal des pierres, coliques néphrétiques qui la terrassent régulièrement. Jusqu'à cette année 43 où, fuyant Cagliari détruite par un bombardement qui a anéanti sa famille et sa maison, arrive avec sa valise celui qui trouve refuge au village chez les arrière-grands-parents, et un mois plus tard épouse la grand-mère, malgré elle, qui ne l'aime pas.